AVERTISSEMENT :
Ceci n’est qu’un avis que vous n’êtes en aucune manière obligé de partager. Mon humble but ici est de proposer une lecture de mon ressenti sur ce film que l’on porte – selon moi – un peu trop rapidement au pinacle. Si d’aventure vous vous sentez l’âme d’un justicier en déposant une pêche dans la section des commentaires, sachez que cela ne me fera pas changer d’avis et que vous perdrez votre temps. En vous remerciant pour votre compréhension…
 |
| Certains n'ont peur de rien : "le successeur de Miyazaki"... Qu'on se rassure, avec des films de cette trempe, ce n'est pas pour tout de suite ! |
Prologue.
J’en avais déjà parlé dans la critique de Zombie Cherry : dans ses meilleurs moments, la culture populaire nippone [1] a la capacité de saisir le spectateur à revers pour lui arracher des larmes alors même que celui-ci pensait avoir juste affaire à une comédie déjantée. Cet effet est recherché par les créateurs du soleil-levant, insufflant à des œuvres paraissant mineures un supplément d’âme bienvenue. Ces ruptures de ton – que peu de réalisateurs osent en Occident – requièrent un dosage subtil, une savante manipulation de nos affects avec comme ingrédient principal des personnages pour lesquels nous nous impliquons. Les séries sont mieux à même de jouer avec ces mécanismes, car la longueur étendue suppose une connivence accrue avec nos protagonistes préférés.
En revanche quand l’exercice de style se vautre, que le spectateur sent que le film essaie d’instiller un sentiment dans son cerveau – sans y parvenir – alors, bien plus que l’ennuie, c’est le rejet immédiat et la colère qui l'emportent. Your Name appartient à ce club assez fermé des œuvres qui m’auront valu une nuit blanche de ruminations. La virtuosité du réalisateur – survendu à mon humble avis – a échoué à percer mon petit cœur de midinette car la manipulation fût grossière et insultante.
1. Synopsis.
Your Name narre donc les déboires de deux adolescents japonais que tout sépare, le sexe, la distance et la culture. Lui est un Tokyoïte bûcheur qui en plus du lycée accumule le job de serveur pour pallier à une démission parentale patente. Il est pris d’un étrange sentiment de mélancolie en voyant une comète enflammer le ciel de la ville –, malgré la pollution lumineuse et atmosphérique de la mégalopole… Passons… –, elle est une provinciale officiante parfois comme prêtresse lors de cérémonie shintoïste tenue vaille que vaille par sa grand-mère. Cette originalité fait d’elle la proie de quelques moqueries dans le village, surtout que son père brique une énième fois le poste de maire. Nos deux joyeux comparses se retrouvent un beau jour à échanger leurs corps de façon anarchique. Décontenancé par le phénomène et ces quelques – bénignes hein, faudrait pas ajouter de la profondeur… — incidences sociales, ils essaient de comprendre le pourquoi du comment. Ce faisant, ils réalisent qu’ils tombent amoureux l’un de l’autre. Sauf que la jeune fille est non seulement éloignée du garçon géographiquement, mais aussi temporellement puisque la fameuse comète – dont une partie a chuté sur terre – a rayé la petite ville provinciale de la carte en une grande explosion il y a de cela trois ans. C’est alors que le garçon va tout faire pour changer le cours des événements.
2. Thématiques et exploitations.
Que ce résumé est long ! Le film emmêle les thèmes complexes par bouquet de douze en les assénant à coups de symbolisme lourdingue, comme cette scène de destruction massive censée nous faire songer à Fukushima [2] –, le scénariste ignorant qu'une catastrophe naturelle n'a rien à voir avec un incident nucléaire... – et les agglomère sans rime ni raison dans une espèce de frénésie chaotique. Je me suis demandé si, quelque part dans le processus de la production, un script-doctor n’aurait pas dû signaler à l’auteur de se concentrer sur un seul sujet pour lui appliquer un traitement idoine plutôt que de disperser son énergie aux quatre vents. Parce qu’entre le changement d’identité – et de sexe ce qui, en pleine adolescence de surcroît, est tout sauf bénin –, les imbroglios spatio-temporels et une histoire d’amour plaquée de manière artificielle sur tout ça, ça fait beaucoup... Exploiter le tout en moins de deux heures requerrait d'être un génie… Ce que le réalisateur, malgré ce que les échos élogieux de la presse et de ses groupies laissent entendre, n'est pas. Au mieux se situe-t-il au niveau d’un excellent technicien auquel il manque l'indispensable scénariste avisé.
La question du paradoxe temporelle n’a d’ailleurs aucune importance dans le court de l’univers du film. Ainsi qu’en est-il de la ville qui est au final sauvegardée alors que celle-ci devait être rasée dans la première version des événements. Ce sauvetage in extremis par « un voyageur imprudent » a-t-il une incidence sur les personnages ? Leurs entourages ? À peine plus qu’un pet de souris. Quel est le rapport avec la comète qui ouvre le récit, une des rares séquences à valoir le déplacement ? Schnol ! Bernique ! Rien ! Que dalle ! Peau de zob ! Nada ! Le scénariste est en grève, veuillez laisser un message.... Sans rechercher à tout prix une explication claire de tous les fils dramatiques, je goûte assez que l’on conserve des zones de floues pour faire travailler mon imaginaire. Les thèmes présentés dans l'introduction – une promesse de l’auteur aux spectateurs – doivent trouver une utilité dans la narration, d’autant plus quand ceux-ci ont un tel potentiel de fascination, sinon à quoi bon les employer ? Quant à la dualité ville-tradition, évoquée en filigrane, elle est évacuée d'une chiquenaude en même temps qu'une foultitude d'autres éléments. L’auteur préfère accorder toute son attention sur nos deux très puritains adolescents.
L’inversion des corps – en plein bouillonnement hormonal – demeure est traitée par-dessus la jambe alors que cela aurait pu être l’occasion de répondre à la maxime : l’esprit est-il un jouet pour le corps ? [3] De cet échange ponctuel d’incarnation, les protagonistes ne retirent rien et n’effectuent aucune évolution dramatique. Comment tombent-ils amoureux, étant donné leurs manques assez flagrants de personnalité, pourquoi ? Pour cela, l'auteur aura recours à la plus vieille et vile astuce disponible dans son médiocre répertoire : un montage sur de la J-Pop bien sûr ! Voilà pour le soi-disant « romantisme »…
3. De la mise en scène.
La mise en scène se perd dans les contorsions d'une virtuosité superfétatoire plutôt que de trouver des solutions cinéma pour tisser l'alchimie des sentiments par le biais de l’image. Si certains laudateurs se sont esbaudis sur le rendu « réaliste » des scènes de métro – l’auteur use et abuse des ouvertures et fermetures de portes coulissantes comme autant de « volet naturel » pour alterner le point de vue – je serais pour ma part beaucoup plus sévère. D’une part le réalisme ces séquences ne m’éblouit pas, mais en plus cette débauche d’efforts pour un résultat aussi minable en terme d’immersion – puisque le film tente de m’arracher au marteau piqueur une sensation de mélancolie – aboutit à un effet inverse, c'est-à-dire une neutralité de ton embarrassante. Le réalisateur semble incapable de voir au-delà de la technique. Avec un pareil sujet, il y aurait pourtant eu un vrai travail à faire sur l’expressionnisme, sur les codes de couleur, sur le graphisme et la ligne... Quelque chose qui joue avec toutes les possibilités offertes par l'animation. Ici l’on préfère s’attarder sur l’exactitude des rivets et sur la diffraction de la lumière crue sur le métal. L'onanisme technologique, en ce qui me concerne, m’a toujours laissé de marbre.
Que m’importe qu’une rame de métro soit « bien » dessinée si la présence de celle-ci au sein du récit est tout à fait banale ? Au dernier quart du métrage l’auteur s’ébroue un peu, se souvenant qu’il fait un film d’animation et qu’il peut donc s’affranchir des limites physiques de notre monde pour se lancer dans quelques timides et maladroites expérimentations. Las, cela vient trop tard et presque sans aucune justification narrative conséquente – enfin, il y en a bien une, mais elle participe d’une telle mièvrerie que j’ai failli me noyer dans la guimauve – et demeure d’un rendu graphique trop convenu. Loin, très loin sont les emportements d’une Princesse Kaguya (Isao Takahata, 2013) qui, en quelques intenses secondes, parvenaient à synthétiser avec fougue la crise de colère, de rage et de chagrin de l'héroïne en titre. Une séquence audacieuse au service des sentiments du personnage et qui use de toutes les armes du dessin pour arriver à ses fins… Se vautrer dans des mouvements de caméra ostentatoires inutiles [4] pour modeler un espace dont je sais pertinemment qu’il s’agit d’une simulation de silicone démontre une certaine immaturité et un manque de pertinence flagrant. J’accepte le fait que tu sois un dessin animé, Your Name ! Tu peux assumer ta condition et me faire des propositions de mise en scène novatrice pour capturer mon attention...
4. De la musique et d’une maladie répandue.
Si le rendu visuel se montre insuffisant à me satisfaire, qu’en est-il de la musique ? Accompagnement souvent discret chez les meilleures, l’emploie de celle-ci demeure problématique, en particulier dans les productions relevant du grand public, qui surlignent avec de gros sabots le moindre passage pour nous faire comprendre que là il faut avoir peur, là il faut pleurer, etc.… La bande-son de Your Name ne fait pas défaut au reste du métrage dans la médiocrité crasse. Les ténors de l’animation japonaise comptaient d’habitude sur des compositeurs inspirés, Joe Hisaishi, Kenji Kawaï et Yoko Kanno pour les plus connus... Les producteurs de Your Name ont recours à une espèce de J-pop sirupeuse et larmoyante qui peint en rose fuchsia tous les moments sentimentaux, les noyant dans une avalanche de kitsch involontaire. Il n’y a pas un seul passage de silence [5] – alors que des Hayao Miyazaki, des Mamoru Oshii ou des Isao Takahata ménageaient à dessein des plages contemplatives qui, loin de desservir leurs films, les ennoblissaient d’un réel respect pour l’intelligence du spectateur. Même les codes sonores comme le bruit d’une clochette dont usent Your Name sont assénés avec un aplomb grotesque.
Au-delà du problème que pose la posologie musicale, ce film souffre d’une tare — répandu en Occident — qui a contaminé l'industrie cinématographique japonaise par les capillarités que le pays entretient avec ses colonisateurs : les États-Unis. Se calquant sur le modèle des blockbusters américains de la dernière décade, le cinéma populaire japonais s'est déparé de sa spécificité pour s’aligner sur un modèle narratif qui – pour efficace qu’il soit – manque de singularité. L’emploi systématique de mélodies commerciales estampillées « romantiques » est une des innombrables formes de cette pathologie culturelle causée non seulement par une certaine mondialisation, mais aussi par l’embrasement des coûts de production qui font que seules quelques gargantuesques compagnies détiennent les lacets de la bourse qu'elles ouvrent avec parcimonies et uniquement si un staff de technocrates aux cœurs de calculette sont convaincus de la rentabilité immédiate du métrage. En résulte une érosion de toutes les particularités qui confèrent une identité au cinéma de chaque pays — ici japonais — pour tendre vers un cinéma lyophilisé, roboratif et uniformisé. Dans Your Name tous les ingrédients sont là, mais la recette devient une mouture industrielle : la sauce est allongée au sucre, au sel, à l'additif CGI et l’ensemble est immangeable. Je passe rapidement sur le placement de produit intempestif, principalement des applications pour Aïe-phone reproduite à l’écran avec un soin maniaque, Nous n'en sommes plus à un détail près...
5. Des personnages.
Le lycéen lambda n°328 – s’il a quelques dons pour le dessin, lointain écho du réalisateur ? – demeure une fourmi industrieuse et parfois bagarreuse comme on en a vu 36.250 dans n’importe quel shônen. Quant à la fille, excepté les traditions shintoïstes familiales qui seront utilisées comme nébuleux prétexte à une séquence onirique pour les nuls, elle se maintient dans des stéréotypes éculés dignes des animes de harem les plus émétiques. Minaudant à tout va, incapable de se bouger le cul, elle aura fait de son pire pour me gâcher le peu d’intérêt qui me restait de la chose. Avec cette caractérisation à la truelle, il devient aisé de deviner qui est qui lors des inversions de corps. Un scénariste et un réalisateur doués d’un minimum de neurones auraient induit le spectateur en erreur en opérant un subtil dégradé entre les deux personnalités, chacun prenant peu à peu des tics, des expressions ou des manières d’être de l’autre.
6. Conclusion.
À défaut de vous conseiller de voir ce truc, je trouve sain d'identifier les raisons d'une appréciation – ou d'une détestation – d'une œuvre. Et j’ai cordialement exécré chaque douloureuse seconde de ce métrage. Si je me montre volontiers indulgent à l'égard des films dotés d'un budget famélique – dont chaque séquence réussie ou ratée est polie avec amour par ses concepteurs —, je suis en revanche beaucoup plus strict avec une production possédant une enveloppe conséquente pour matérialiser ses carabistouilles. Ce qui est le cas de Your Name. Ce n’est pas un nanar, juste un très mauvais film bénéficiant d'un engouement que je ne m’explique pas.
Malgré le soin de cruciverbiste fou qu'apporte l'auteur à son œuvre, il échoue systématiquement à créer la moindre once de sensation et cet échec maladif attise mon aigreur. Parce que si j'accepte de me faire manipuler en m'installant dans un fauteuil de cinéma pour déguster un film, encore faut-il que le cinéaste respecte son contrat en m'aidant à soulever mon incrédulité. Si à aucun moment son travail ne m'offre de points d’ancrage, si l’univers, les personnages et la direction artistique qui le meuvent ne m’émeuvent pas et que – de surcroît – je distingue les artifices dont use la mise en scène pour m’arracher une émotion particulière, alors j’ai le droit de dire que l'auteur se fout un peu de ma gueule. [6]
En choisissant la voix du moindre mal, la plupart des réalisateurs des films à gros budgets se vautrent dans la facilité et Your Name ne fait pas exception à la règle. Les subtilités qui existaient chez les maîtres de l’animation japonaise sont ici évacuées au profit d’une vacuité hallucinante. Your Name c’est l’équivalent d’un Marc Levy au Japon avec un vague fond de couleur locale qui ne sera jamais exploitée. L’auteur préfère immortaliser les insupportables minauderies de son héroïne. C’est un choix. Je ne l’approuve pas.
________________________________________________
[1] – La « culture populaire » mériterait d’ailleurs une définition précise qui pourrait englober tous ses multiples aspects. Je prends dans cet article le postulat de l’identifier comme relevant de tout ce qui s’approche de près ou de loin du manga, des animes ou même des dramas (il y a quelques-uns dont les qualités n’ont rien à envier au film malgré – ou à cause – d’une économie de moyen drastiques…), sachant pertinemment que cette démarche est bancale.
[2] – Visuellement l’explosion en question ressemble plus à un impact de bombe nucléaire – tout au moins est-elle mise en scène ainsi – mais pour une raison que je ne m’explique pas, tous les commentateurs francophone ont plaqué Fukushima sur cette séquence… Une mémoire défaillante et sélective peut-être ?
[3] – M’ennuyant notablement pendant la projection qui s’éternisait – film à minutes compte quadruple – je songeais que c’était assez fou, avec un ressort dramatique pareil, d’avoir une réalisation à ce point clinique – évacuant même la sensualité inhérente au dessin… – et de passer à ce point à côté de la question sexuelle. Sans parler d’en faire une œuvre relevant de l'érotisme, je comprends que ce n'est pas le but, mais ces personnages sont aussi cul serré que s’ils avaient été drillés par le prêche d’un Saint-Augustin sous cocaïne. Mis à part un gag récurrent sur les seins qui a la subtilité d’une blague de camionneur russe chargé à la vodka (pouêt-pouêt camion ! Nichons !), nous n’aurons guère plus d’indices sur la sexualisation des héros. Un vrai fantasme de curé priapique, cet anime. Sur ce sujet, mieux vaut lire l’excellent manga psychologique Dans l’intimité de Marie de Shuzo Oshimi (éd. Akata, 2015-…) qui creuse beaucoup plus loin les conséquences d’une telle bascule corporelle.
[4] — Savoureux paradoxes, je raffole chez les virtuoses de la caméra comme un Sam Raimi ou un Dario Argento en forme. Et s’ils me plaisaient, c’est qu’ils imposaient une déformation de la réalité pour mieux servir leurs propos, un expressionnisme furibard qui ruait dans les brancards de la réalisation à Papa.
[5] — Je suis de mauvaise foi : il y a un unique moment de silence ! Les quelques secondes qui précèdent l’explosion. Instant salutaire qui a soulagé mes tympans réduit en charpie par la cacophonie ultérieure. Néanmoins là aussi, l’auteur ne fait pas vraiment œuvre d’une vertigineuse maestria. Il suffit de songer, au hasard, à Akira (Katsuhiro Otomo, 1988) qui plaçait la barre très haute en matière de représentation de déflagrations destructrices…
[6] – Le terme émouvoir est à prendre dans un sens large. L’on peut – et c’est mon cas – être « ému » par un geste artistique, par une mise en scène sans qu’il ne soit nulle part question de sentiment. Ainsi, le cinéma de Stanley Kubrick — pour citer un exemple parlant — n’est pas vraiment habité par une franche empathie pour ses personnages. Néanmoins, sa réalisation millimétrée et ces histoires s'aventurant hardiment dans les zones d'ombres de la nature humaine nous amènent à réfléchir à notre propre condition. Kubrick respecte l’intelligence de son spectateur. Les responsables de Your Name préfèrent les infantiliser...
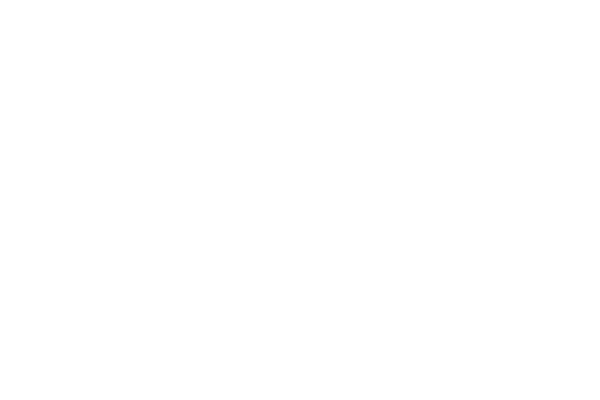










Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire